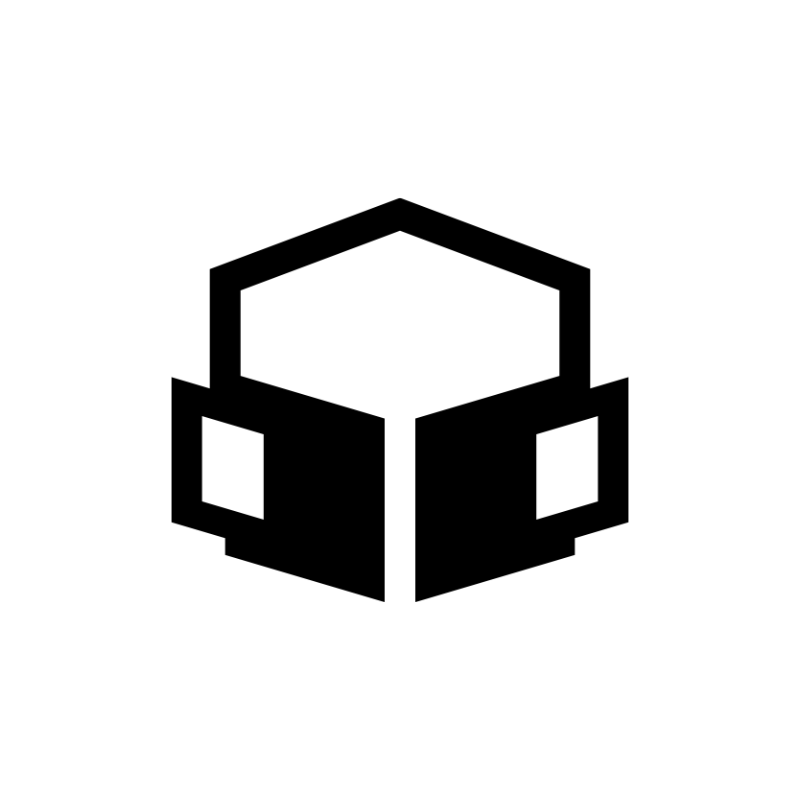Entrevue littéraire avec Simon Paré-Poupart
Par Émy Robert
À l’occasion de la première édition du Printemps des Passeurs, notre littéraire (et directrice des communications) a rencontré Simon Paré-Poupart, auteur et vidangeur. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur lui et son premier essai, Ordures! Journal d’un vidangeur.
Ordures ! est votre première œuvre publiée. Après 20 ans dans le métier, pourquoi avoir ressenti le besoin d’écrire ce livre l’année dernière ?
C’est vraiment intéressant comme choix de mots parce que je ne sentais pas le besoin. Je n’ai pas une famille dans le livre. Je n’avais pas une facilité ni d’incitatifs à écrire. J’ai travaillé sur des articles, mais je ne suis pas du milieu du roman. C’est Alain Deneault, avec le développement de ma maitrise, qui m’a amené vers le livre. Ce qu’il y avait en moi, c’était un désir de vivre et celui de communiquer. Le livre, pour moi, c’est la forme de communication qui, en tout cas, m’allait. Ce sont depuis que de belles rencontres que je fais avec ce livre. Je réalise sa force. Nécessairement, en allant à l’université, on lit beaucoup, mais je réalise qu’il y a une différence entre lire à l’université des textes obligés et le milieu du livre. Les libraires, les maisons d’édition, c’est un milieu que je connaissais peu. Je me rends compte que c’est une force. Je suis pour ça.
Comment votre entourage et vos collègues ont réagi à la sortie de votre livre ?
Ça aussi, c’est intéressant, en deux parties, disons. La première, c’est que je ne pensais pas que j’allais être lu, justement de mes connaissances du livre et des sorties de livre. Alors j’ai vraiment écrit le livre comme si je n’allais pas être lu. Si j’avais su qu’il était aussi populaire, j’aurais peut-être été plus parcimonieux ou j’aurais fait encore plus attention. C’est dommage quand même parce que j’essayais de rendre sociologiquement et réellement ce que j’avais constaté sur le terrain avec les années, mais ça pourrait quand même porter à faire violence à des gens. Ça m’aurait un peu modéré dans l’écriture. Alors ça, c’est pour la première partie.
La deuxième, c’est que j’ai été surpris parce que beaucoup de vidangeurs l’ont lu. Les vidangeurs — la plupart que je côtoie — n’ont pas fini leur secondaire. Ils n’ont même jamais lu un livre de leur vie. C’est quelque chose de bizarre lire un livre, alors ils se prenaient en selfie en train de lire comme si c’était quelque chose d’extraterrestre. C’était la trend dans mon réseau.
Il y en a [des vidangeurs] qui sont venus à mon lancement. J’en ai amené [des éditions de mon livre] quelquefois dans les événements de vidangeurs. Oui, leur lecture est bonne, mais après ça on appelle ça l’analphabétisme fonctionnel. Je ne sais pas s’ils comprennent tout, mais justement j’ai vu qu’ils l’avaient lu, en parlaient, en discutaient. J’ai fait plusieurs publications en leur disant que, s’ils avaient l’impression que j’avais mal repris des propos, de ne pas hésiter à ouvrir le dialogue. J’ai été représentant d’éboueurs dans une entreprise, je place beaucoup de gens dans les entreprises, en aide certains. Il faut qu’on sache quand même que ce sont des gens qui, entre autres, par leur mobilité sociale, sont plutôt vulnérables. Alors je veux ouvrir le dialogue. De toutes les demandes que j’ai, les vidangeurs sont souvent les premiers à me répondre, même avant les médias.
Vous avez mentionné que vous ne pensiez pas que votre livre serait lu. Est-ce que vous l’écriviez pour vous ?
J’écrivais un peu parce qu’Alain Deneault m’a fait remarquer qu’il y avait une balance sociologique, parce que c’est la condition de l’étranger, c’est-à-dire lorsque je parlais lors de ma maitrise du monde des vidanges, il y a quelque chose qui mérite d’être partagé, d’être connu. Je lui ai fait confiance parce que c’est lui qui lit un nombre de livres incalculables. Je me suis dit que si lui trouve qu’il y a quelque chose d’intéressant, je vais me lancer. Visiblement, c’est quelque chose qui intéresse. J’ai bien fait de lui faire confiance.
Vous nommez des entreprises comme Ricova et l’Association pour le recyclage des produits électroniques. Avez-vous eu des réactions positives ou négatives de leur part ?
Oui, les entreprises ne m’aiment pas. Sur Ricova, j’ai fait un reportage avec Cogeco où j’ai été (sic) chercher une autorisation d’un broker — en ville, la gestion des matières résiduelles, c’est un système d’une double sous-traitance. J’ai demandé à un broker si je pouvais faire un reportage parce que je me doutais bien qu’ils [Ricova] ne me montreraient pas l’information. Je ne travaille pas pour Ricova alors ils ne peuvent pas me mettre à la porte. J’ai donc fait ce reportage et, tout de suite, ils m’ont écrit. On s’est mis sur un pied d’alerte en attendant de voir s’il y aurait poursuite ou non.
Je te dirais que les compagnies de vidanges n’aiment pas la lumière. Elles ne savent pas ce que je vais dire, où ça va aller. C’est sûr que dans le livre j’ai essayé de faire attention et nommé seulement ce qui avait été nommé par les journalistes. Malgré ce que je viens de dire, il n’en demeure pas moins que les entreprises font un travail essentiel. Les citoyens sont dépendants de leur bonne gestion des matières résiduelles. C’est tout à fait vrai, mais reste que l’on peut vraiment améliorer le système. Pour l’améliorer, malheureusement, c’est eux nos partenaires principaux. Ce sont des entreprises qui, somme toute, sont là pour faire du profit, et elles ne veulent pas réduire la quantité de déchets, qu’on réemploie ou réutilise. Elles t’empêchent de le faire.
Un peu comme Ricova, les entreprises ne m’ont pas parlé. Certaines ont bloqué des reportages que j’ai essayés avec 360.
Est-ce que vous diriez que les conditions du métier se sont améliorées, détériorées ou ont stagné ?
C’est sûr que d’avoir ajouté des runs de compost avec les bacs, c’est une détérioration importante de la qualité du travail. Règle générale, c’est plus tu laisses au fonctionnaire le soin de concevoir des bacs, moins il y a de chances que ça soit grave pour le travail. Bien sûr, aucun fonctionnaire, gestionnaire, ingénieur consulte un vidangeur. Certains de mes collègues et moi-même seraient en mesure de jaser des différents types de contenants, comme lesquels sont les meilleurs et les plus performants. Ça va faire qu’une ville comme Brossard va mettre des petits bacs — on appelle ça des 80-90 litres. Ils sont trop petits pour les prendre avec une machine à batte, mais trop gros pour que tu ne te fasses pas mal au dos. Ça devient des villes « punitions ». Pierrefonds aussi l’est. Ce sont des villes où tu lèves tous les bacs à bras, mais là il y en a qui sautent dans leur bac pour effoirer leur gazon. Ça, ce sont des bacs et des villes plutôt désagréables à faire.
Après ça, il y a aussi la robotisation. En général, on a favorisé, dans notre système de matières résiduelles, les robots dans les secteurs les plus faciles à faire. Je pense à Anjou et dans le nord de Montréal où on a mis des bacs pour les faire faire par des robots, mais quand ça ne marche pas, à ce moment-là, ce sont des humains qui finissent par ramasser les poubelles. C’est un système pensé par des fonctionnaires et gestionnaires pour l’économie de coûts. Le contrôle sur le travail était pourri, mais là il est pourri avec une grosse entrave par les fonctionnaires qui disent qu’est-ce qu’il faut faire, notamment dans la mode des bacs bruns. Les gens veulent des bacs bruns. J’ai vu des municipalités, par exemple, qui faisaient faire le compost avec des contenants comme les poubelles, mais là t’arrivais pour faire les poubelles, t’ouvrais le couvercle pour voir que c’était du compost.
Par rapport aux villes, Gatineau a commencé à amender ceux et celles qui contreviennent aux règlements. Pensez-vous que les autres villes devraient faire de même ?
C’est très San Francisco, la ville zéro déchet, et comment t’obtiens ça, c’est par les amendes et les politiques des poubelles. Je ne connais pas la législation en place à San Francisco, mais ici, le gros problème, c’est que les municipalités ont la charge de faire appliquer ces mesures-là. Elles sont, en général, plutôt impopulaires. L’exemple qu’on a récemment à Hochelaga-Mercier est de Pierre Lessard-Blais qui a décidé de mettre un espacement des collectes [de déchets] à Montréal. Depuis ce temps-là, il y a une ligue qui s’est formée — la Ligue 33. Il me l’a dit « peut-être que je vais perdre les élections à cause d’un enjeu de poubelles ». Elle [une municipalité] va avoir des conséquences très rapidement parce que les entreprises, elles, ne veulent pas, elles n’ont pas intérêt parce que ce qu’elles veulent, somme toute, c’est collecter le plus de déchets possibles, que ça soit le compost ou le recyclage : elles veulent ramasser de la matière. C’est ça qui leur permet de faire de l’argent.
C’est intéressant parce que vous dites avoir « charrié » 70 000 tonnes de déchets. Est-ce que, face à cette réalité, vous ressentez une forme d’écoanxiété ?
Non, pas du tout. J’ai eu la chance d’avoir été intervenant psychosocial, même si le terme, faut faire attention, c’est intervenant social. L’anxiété peut te paralyser dans l’action, dans ton bien-être. Dans le fond, ce que j’essaie de faire, c’est de me limiter à ce que je contrôle. Je ne contrôle pas les gens qui jettent 70 000 tonnes. Je n’ai pas à prendre le fardeau des 70 000 tonnes. Prenez la responsabilité qui vous revient. Je prends la mienne, et j’essaie de la prendre de façon exemplaire, mais cela étant dit, je réalise que nous sommes tous, moi inclus, imbriqués dans des systèmes de matières résiduelles. Autant pour la surconsommation, comme les Amazon, autant dans la facilité de jeter, dans le bas coût de jeter qu’on a au Québec. Je dis souvent qu’on pourrait faire le test : on essaie de ne plus rien jeter de nos objets de consommation, on essaie de les réparer nous-mêmes ou d’aller les porter aux bons endroits, ça va mécaniquement nous forcer à diminuer notre consommation parce que ça va nous faire chier de mettre autant de temps. En fait, c’est ça qui est paradoxal, on met énormément de temps à consommer — c’est-à-dire quels magasins, quelles marques, quelles façons de trouver le moins cher —, mais très peu de temps à se demander où vont les matières, à poser des questions à son écocentre — une fois que je l’amène à l’écocentre, ça s’en va où — ; si la bonne façon c’est de le garder, quelle vidéo je regarde ou qui je vais voir pour le réparer.
Je n’ai pas à dire aux gens : vous devriez avoir une illumination du coup à réaliser tout ça. La raison pour laquelle je trouve que la culpabilisation c’est de l’écologie punitive, c’est parce que ça démobilise l’Homme. Il faut être conscient, exercer toute la responsabilité qu’on peut prendre, mais jusqu’à temps que notre bien-être soit maintenu parce que si on n’est plus bien, tout ce qui est réduit va devenir rapidement un fardeau.
Est-ce qu’il y a un objet ou une trouvaille qui vous a marqué en ramassant les ordures ?
Il y en a tellement ! Quand je trouve de l’or, je suis quand même surpris. Ça n’arrive pas souvent : à peu près tous les trois ans, je trouve de l’or. Je ne suis pas un chercheux d’or. Il y en a de mes amis, des helpers, qui trouve de l’or toutes les 20 minutes.
J’ai ramassé un dildo que j’amène dans mes conférences. C’est marquant parce que c’est comique.
Vous expliquez que le métier est souvent une affaire de lignée dans votre livre. Maintenant que vous êtes papa, aimeriez-vous que vos enfants suivent vos traces ?
Déjà, moi, j’ai deux filles, alors elles auraient un sacré défi parce que, en général, des filles dans le milieu privé, il n’y en a pas. Même si les gars sont très solidaires avec les filles, celles qu’on voit, évidemment, ce sont des cols bleus. Ça ne veut pas dire que les filles ne sont pas en mesure de le faire. Je trouverais ça super cool : ma femme est venue courir avec moi. Ma fille, je l’encourage. On arrive de la garderie avec des trucs qu’on a trouvés dans les vidanges. Je n’ai pas de honte. Si elle a du plaisir à le faire, oui, ça ne me dérangerait pas [qu’elle suive mes traces], mais je ne pense pas qu’elle pourrait en faire un métier parce qu’il n’y a pas beaucoup de filles qui peuvent le faire mis à part les chauffeuses.
Comme vous le décrivez si bien en quatrième de couverture, votre essai est « un rassemblement d’excentriques et de personnages plus au moins intégrés à la vie » que vous avez rencontré au fil de votre carrière. C’est un essai, mais lui attribueriez-vous aussi le genre autobiographique ?
En fait, c’est moi qui voulais faire un essai. C’est mon éditeur [Lux Éditeur] qui m’a dit de parler de moi et des gars. Ça a permis aux vidangeurs, notamment, qu’on les voit. Ça crée un engouement. C’est un peu comme je l’avais vu dans le cours de journalisme : il faut aller toucher les émotions pour attirer le grand nombre.
C’est une espèce de croisement entre récit autobiographie et essai.
Gaspillage, surconsommation, déresponsabilisation citoyenne. Vous me direz si je me trompe, mais Ordures ! s’adresse aux « payeurs de taxes », comme vous les appelez. Est-ce que c’est dans vos plans d’écrire un essai adressé au gouvernement ?
Non, mais la colline parlementaire m’a invité parce que le livre va être en lecture. J’ai rencontré les futurs candidats et, peut-être, le futur élu de Projet Montréal lors d’une soirée. Ça me fait vraiment plaisir de retenir, je pense, qu’il y a beaucoup d’experts, de chercheurs en gestion de matières résiduelles, des élus qui ont lu le livre et que j’ai pu rencontrer. Je crois que le livre permet la communion entre les vidangeurs et les têtes politiques. Autant je ne savais pas que le livre serait aussi lu, je ne savais même pas qu’il se rendrait à des élus, autant ça me ferait plaisir que le deuxième soit encore plus percutant. Oui, j’ai encore beaucoup de choses que je pourrais écrire.
Paru le jeudi 13 mars 2025